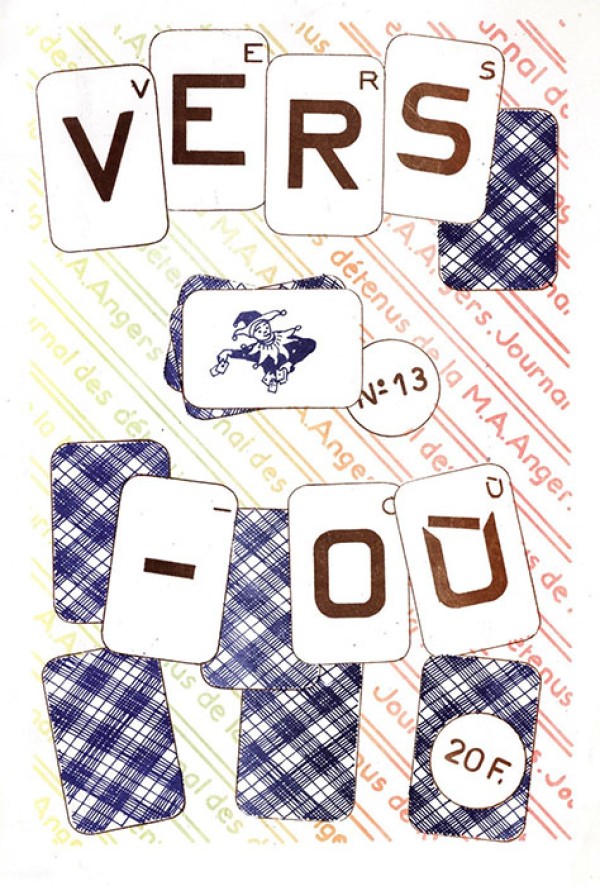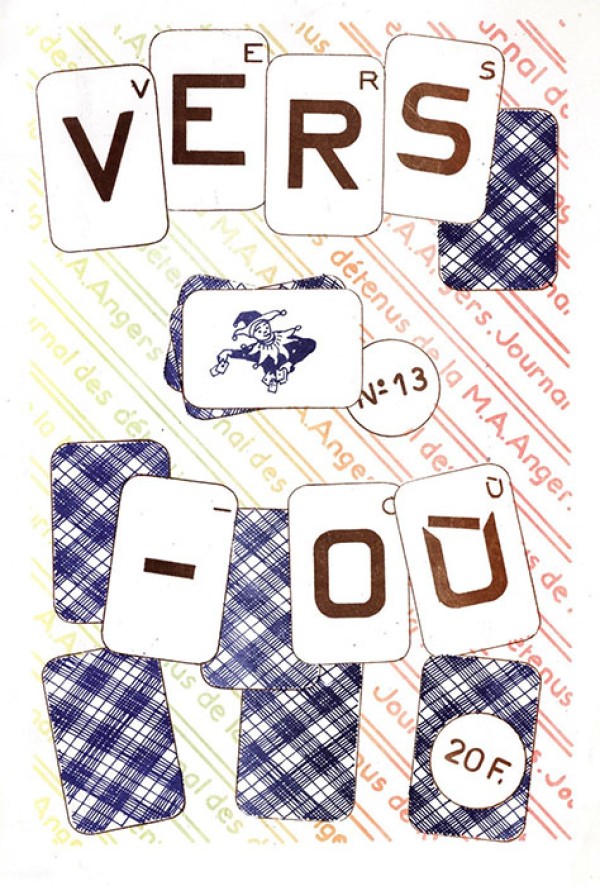
Le pardon en prison ?
Lorsque j’ai dit à l’un ou l’autre détenu ce que vous
m’aviez demandé, ils ont haussé les épaules. Ce n’est pas un sujet. En prison,
on ne parle pas de pardon, et ce pour plusieurs raisons.
La première, la plus évidente, c’est que lorsque vous êtes
le coupable, ce n’est pas vous qui avez à pardonner.
La seconde, c’est le sentiment d’injustice. Dimanche, A.,
qui sera incarcéré depuis trois ans, en préventive, au moment du procès pour
lequel il ne risque pas plus de cela, donc qui reçoit sa peine avant jugement
et ressortira libre du tribunal, me disait, j’aurais dû commettre quelque chose
de grave. Au moins, cette incarcération serait justifiée.
Vrai ou pas, l’injustice est d’abord sentiment d’injustice.
NS voit sa demande de remise en liberté examinée et exécutée 20 jours après son
incarcération et la dépose de la demande. Ça n’existe pour personne d’autre, ce
genre de choses.
Le sentiment d’injustice, indépendamment même de la
conscience que l’on a de la gravité de son acte, c’est l’origine sociale des
détenus. Le sociogramme des détenus ne se superpose pas avec celui de
l’ensemble de la société. Un quart des détenus a quitté l’école avant 16 ans,
trois quarts avant 18 ans (Insee), contre 7,6% (chiffre 2022, Observatoire des
inégalités). La sociologie pénitentiaire n’est ni la sociologie de la
délinquance ni celle de la justice. Soit vous tenez des thèses racistes qui
tiennent que les pauvres, les immigrés, les gens qui ne sont pas allés en fac
sont plus coupables que la moyenne, soit vous interrogez d’où vient cette
distorsion, étudiée par Michel Foucault
dans Surveiller et punir, Gallimard 1975 Ce n’est pas un scoop que la
justice n’est pas la même pour tous, non seulement en ce qui concerne les
incarcérations, mais aussi les arrestations et les jugements. Je vous
recommande le roman enquête de Joy Sorman,
Le témoin, Flammarion 2024.
La troisième raison, c’est que la prison broie les
personnes. Et lorsque l’on devient à son tour victime, victime d’une peine
décidée par la Justice, on a une raison au carré de ne pas parler de pardon par
rapport à sa faute, puisqu’on est victime d’un système déshumanisant, et que
c’est par la loi du plus fort, en l’occurrence celle de l’Etat. Ce que je dis
là concerne l’immense majorité des détenus. La moyenne de durée de
l’incarcération est de moins d’un an. C’est dire que les grands délinquants,
c’est l’exception de l’exception. Sans dire que les peines de moins de deux ans
ne devraient pas être exécutées en prison ! Il suffit d’entrer dans un
établissement pénitentiaire pour toucher du doigt et même prendre en pleine
figure la condition des personnes détenues. Ce n’est pas vrai que c’est le Club
Med, mensonge d’autant plus grave qu’on est responsable politique ou de
surcroît ministre de la Justice.
Parler de pardon, c’est aussi surligner la faute. Et
personne n’aime qu’on la lui rappelle, qu’on la lui mette sous les yeux. C’est
déjà tellement insupportable à beaucoup, le mal qu’ils ont fait. Ils n’arrivent
plus à se regarder dans la glace. J-C., la première fois que je le rencontre,
la première fois aussi que j’entre dans une cellule. Je suis accompagné par un
aumônier qui le connaît bien. Nous restons debout. On ne peut s’installer. Quelques
mots. C’est lui qui parle après les présentations. Quand je rentre dans la
cellule, dit-il, je ne peux pas regarder la porte. Mon nom sur la porte.
On n’en saura pas plus. Il pleure.
Il arrive parfois que la question de la faute devant Dieu
soit formulée. Cela peut être une vraie question. Cela peut être une affaire de
culpabilité plus que de pardon et de sens de la faute. Cela peut être aussi une
manière plus ou moins magique de tourner la page sans avoir regardé la faute en
face. Cela peut être une angoisse religieuse. Un braqueur, certes instable
psychologiquement, mais intelligent, m’avait demandé si je pensais qu’il irait
en enfer. L’aumônerie catholique des prisons est très prudente à célébrer le
pardon, d’autant plus avant le jugement. Cette fois, ce n’est pas le coupable
ou présumé coupable qui n’accèderait pas à la question du pardon, mais les
accompagnateurs aumôniers qui freinent.
Comme confesseur, en temps normal, je ne suis pas convaincu
que les gens qui célèbrent et les prêtres qui célèbrent le pardon ont une juste
théologie et pratique du sacrement. Mais dans le contexte carcéral, une
théologie in-juste risque de commettre plus de dégâts qu’elle ne permettra à la
personne de vivre en sainteté.
La peine, parlons-en !
Payer sa dette à la société. La fiction de la société lésée.
Est-ce que punir n’est pas toujours générer de la violence ? Effectivement,
en réponse à une autre violence. Mais la réponse à la violence réside-t-elle
dans une nouvelle violence ? En quoi la personne victime est-elle réparée
par l’incarcération ? Qu’est-ce que cela lui apporte ? En quoi l’Etat
ou la société sont-ils payés. Quelle dette le coupable a-t-il à leur
égard ?
« C’est ici aussi que cet étrange enchaînement d’idées,
aujourd’hui peut-être inséparable, l’enchaînement entre « la faute et la
souffrance » a commencé par se former. Encore une fois : comment la
souffrance peut-elle être une compensation pour des « dettes » ?
Faire souffrir causait un plaisir infini, en compensation du dommage et
de l’ennui du dommage cela procurait aux parties lésées une contre-jouissance
extraordinaire : faire souffrir ! ‑ une véritable fête ! »
Friedrich Nietzsche, Généalogie
de la morale II, 6 (1887).
Quel sens la détention a-t-elle ? Je ne parle pas ici
de l’interpellation, le coup d’arrêt, le stop prononcé et mis en œuvre.
Plusieurs coupables, aussi dure que soit l’expérience de l’arrestation, sont
soulagés d’avoir été arrêtés et en conséquence, qu’on les ait arrêtés dans leur
délit ou crime. Je ne parle pas non plus des personnes dont il faut se
protéger. Les personnes dangereuses sont une infime part de la population
carcérale et beaucoup devraient plutôt se trouver en hôpital psychiatrique qui
ne s’oppose pas, on le sait, à la privation de liberté.
Je ne fais pas d’angélisme. Il y a du mal. Il y a des hommes
et des femmes qui prennent plaisir à faire mal, ou qui ne savent pas vivre
autrement qu’en faisant mal. Mais il n’y a aucun lien de cause à effet de la
sévérité de la peine au taux de délinquance. L’abolition de la peine de mort
n’a pas fait augmenter le nombre de crimes, son rétablissement ne le fait pas
diminuer.
Qu’est-ce que cela change de passer six mois en prison, si
ce n’est à faire entrer dans une logique de banalisation de la sanction ?
Une sanction qui pour des jeunes sans grand avenir, du moins pour leurs
quelques prochaines années, n’est pas vécue de façon plus compliquée que la
désocialisation à laquelle ils sont socialement et habituellement condamnés ?
Qu’est-ce que cela change, deux ans ou quinze ou vingt ? Est-ce qu’on a
plus payé, plus remboursé ? « Essayer de ne pas sortir trop abîmé de
toutes ces années », m’écrivait R.. Essayer de rester vivant, de ne pas se
remplir de haine, de ne pas se tenir debout que par le ressentiment contre le
système, et contre soi-même. La haine contre la violence qu’inflige la justice,
je la vois. (Et je ne dis rien des dysfonctionnements, surpopulation, sous-effectif des agents, insalubrité, manque de moyens, etc. Voir Guillaume Poix,
Perpétuité, Verticales 2025)
Pour tenter des réponses, il faut accepter de réfléchir au
sens de la peine, il faut aller voir si ce que l’on a mis institutionnellement
en place pour punir fonctionne ou si cela n’a aucun effet, voire un effet
inverse. Quelles possibilités de restauration, de réparation, de
réinsertion ? Je renvoie au travail de Geoffroy de Lagasnerie, Par-delà le principe de répression, Flammarion
2025. (On trouve plusieurs entretiens sur la toile, soit avec la librairie Mollat,
soit avec le collège des Bernardins.)
On n’attrape pas des mouches avec du vinaigre. Et si le
coupable doit se repentir, demander pardon, changer de vie, est-ce possible en
le déshumanisant, par la déshumanisation ? Est-ce possible parce qu’on
l’aura broyé ? Le système répressif est incompatible avec le pardon.
La justice restaurative
On comprend que des pays et des associations mettent en
place un autre type de rééducation des coupables. Jeanne Héry a réalisé le film Je verrai
toujours vos visages (2023). Faire se rencontrer des coupables et des
victimes (pas les victimes du coupable, mais du même type de délits ou crimes),
pour permettre la prise de conscience du dommage commis. C’est en outre,
considérer le coupable comme une personne à qui l’on parle, et non un paria que
l’on ne veut pas voir ni fréquenter et que l’on enferme. C’est permettre à la
victime d’être associée au travail du sens et non d’être seulement le témoin de
ce que la société, à travers l’institution Justice, prenne en charge ou prenne
le relai de sa plainte suite au tort qu’elle a subi.
Une tribune assez implacable contre le film de Jeanne Héry a
été publiée par le juge Edouard Durand,
Violences sexuelles : « Suffit-il de quelques échanges pour
restaurer l’humanité commune ? », Le Monde, 15 avril 2023.
Est-il possible que la victime serve à la transformation du coupable ? Doit-elle
servir au bien de coupables ? Lui doit-elle cela alors qu’elle est (déjà)
victime ? Ne la met-on pas en situation d’empathie par rapport au coupable
lorsqu’elle entre dans une démarche de compréhension de ce qui a mené au délit
ou au crime ? Expliquer n’est-ce pas déjà justifier, rendre juste ?
Le mal est toujours injuste.
Le survivant des attentats de novembre 2015 demande un
processus de justice restaurative. Pourquoi ? Des victimes lui
doivent-elles cela ? On se rappelle peut-être la violence de faire se
rencontrer l’agresseur Preynat et l’une de ses victimes. C’était inouï. A
quelle condition le coupable peut-il à nouveau partager la table de la vie avec
sa victime ?
Le droit des victimes ne semble pas plus reconnu par ce type
de justice que par l’incarcération du coupable. Ce sont à des professionnels,
rémunérés ou non, de travailler avec les victimes pour les aider à se
reconstruire. Savoir l’autre en prison, s’il s’agit d’une fête, comme dit
Nietzsche, on conviendra que cela ne peut que reconstruire de travers. Ce sont
à des professionnels, rémunérés ou non, de travailler avec les coupables, parce
que, certes, il s’agit de « restaurer l’humanité commune ».
Si c’est cela le pardon en prison, on comprend que c’est
hors de question. L’humanisme n’est pas une esthétique pour personnes généreuses
qui se donnent bonne conscience. On va faire le bien, on va participer à une
victoire du bien. Cette prétention est folle et… coupable.
Que fait un aumônier de prison
D’abord, aurais-je envie de dire, il ne sait jamais de quoi
sont accusées les personnes qu’il visite. Il pourra l’apprendre, du coupable ou
d’indiscrétions, mais a priori, il ne sait pas. Et ce que dit le détenu n’est
pas forcément la vérité. Non que ce soit un mensonge, mais c’est ce qu’il peut
dire aujourd’hui, ici, dans telle situation. Ce que dit la justice ou l’enquête
de police n’est pas non plus la vérité. C’est la vérité judiciaire ou celle d’un
rapport de police, d’une ordonnance.
Si l’on ne sait pas de quoi la personne est coupable, on ne
peut parler de pardon. Si l’on n’est pas la victime, est-on en droit de
pardonner ? Le pardon n’appartient-il pas à la seule victime ? Il
faut relire le texte saisissant de Simon Wiesenthal,
Les fleurs de soleil, 1969.
L’aumônier est au service des coupables. Je ne vais pas
faire ici un traité de missiologie. Lisez l’article de Michel de Certeau, « La conversion du
missionnaire » (1963) ou les superbes pages de Javier Cercas, Le fou de Dieu au bout du
monde, Actes-Sud 2025, lorsqu’il rapporte ses conversations avec les
missionnaires de Mongolie, notamment trois religieuses.
Le simple fait de traverser les coursives, « c’est la
liberté qui nous visite » me disait un détenu en CD, que je ne connaissais
pas mais avec qui j’attendais qu’une porte veuille bien nous être ouverte.
Le travail consiste à se faire frère. C’est Saint François
d’Assise. Le loup de Gubbio, le lépreux sont des frères en humanité. Le juge
Durand prévient : « Ne confondons pas l’humanité et la connivence. Le
défi est de prendre au sérieux la réalité des violences extrêmes qui sont
commises dans l’intimité, la dangerosité des agresseurs et la souffrance
intense et durable des victimes. Ne confondons pas l’humanité et
l’indifférence. »
Mais quand on visite en détention, on n’a pas d’objectif, je
veux dire, on suspend son jugement, on n’a pas à juger, à se faire une opinion.
On n’a pas à changer l’agresseur. On ne change pas les gens, ce sont eux qui se
changent. On peut seulement les aider à entrer dans un cadre qui le leur
permette. Je n’ai personne à réconcilier, à faire avouer, à accoucher de sa
vérité. Seulement être là, présent.
Alors même si les mots suivants sont critiques, je les
assume, exceptés ceux qui concerne le film, dont je vois bien les limites et
les réactions qu’il entraîne. « Je verrai toujours vos visages
réunit des spectateurs qui sortent des salles de cinéma rassurés sur notre
humanité commune. Les protagonistes de ces histoires tragiques, incarnés par
des comédiens que nous aimons, nous renvoient à nos douleurs, à nos peurs et
peut-être à nos haines, en même temps qu’ils réactivent notre espoir de
reconnaître toujours un semblable en l’autre : le délinquant ou le
criminel n’est pas un monstre, il est mon frère ou mon prochain. Nous avons le
même langage ; nous nous reconnaissons. Il pleure, comme moi. Il rit,
comme moi. Je lui parle, il m’écoute. Je lui fais des reproches, il baisse les
yeux. Je verrai toujours son visage, celui de notre humanité commune. »
Vincent de Paul, dont on peut dire qu’il fut le premier
aumônier de prison (nommé par Louis XIII en 1619 aumônier général des galères)
écrit : « Ne vous occupez pas des prisonniers si vous n’êtes pas
disposés à devenir leur sujet et leur élève. Ceux que l’on nomme des misérables,
ce sont eux qui doivent nous évangéliser. Après Dieu, c’est à eux que je dois
le plus. »
François d’Assise découvre l’humanité plus grande à la
rencontre des parias. Et cela est une résurrection, autant pour François que
pour les parias. Remettre les gens debout par le seul regard. « Jésus posa
son regard sur lui et l’aima. » (Mc 10, 21) Toucher une fraternité bien
plus large, intense, mais toujours fragile, que ce que l’on croit connaître.
La résurrection est pardon. « Je crois à la rémission
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle » confesse
le symbole des apôtres lorsqu’il déploie l’œuvre de l’Esprit qui est la
rémission des péchés parce qu’il anime la chair, même morte.
Visiter les détenus comme vivre avec les parias de la
société, les pauvres, les migrants, c’est voir la résurrection. Comment l’Eglise
peut-elle courir après le merveilleux et les miracles. Le miracle, la
résurrection, on la voit, on la touche, c’est hyper-charnel, dès qu’on entre
dans une cellule. On cherche le merveilleux quand on ne vit pas avec les
pauvres. Et au lieu de se convertir, on s’engouffre dans le sensationnel. Vincent
de Paul écrit ailleurs « les pauvres sont nos seigneurs et nos
maîtres. » J’accuse les chrétiens, clercs et laïcs, promoteurs du
merveilleux de détourner les gens du lieu du miracle, de la résurrection. Il
n’y a que la fréquentation des pécheurs et des cabossés, des mourants et des
malades, des opprimés qui fasse voir la résurrection. Le reste est supercherie.
« On vous dira, il est ici. N’y allez pas ! » (Lc 17, 20-25)
Relation d’aide
Ce type de visites, pour gratuit qu’il soit et doit être, à
des conséquences. L’inutile, la gratuité sont en définitive très opérationnels,
très efficaces, efficients. Il relève du thérapeutique. Visiter soigne, au
minimum parce que l’on prend soin d’autrui à le visiter.
Des chemins s’ouvrent parfois lors des visites. Ou plutôt,
nous rejoignons les personnes sur le chemin qu’elles ont déjà commencé à
arpenter. Pour approcher le mal, il ne faut pas avoir peur, il faut croire. La
foi est le contraire de la peur (Mt 8, 26). « Ne craignez
pas ! » Croire que l’amour soigne ou du moins permet de vivre, encore
un peu. « L’amour bannit la crainte. »
Nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête et le cœur
des détenus. Ils sont nombreux à connaître leur faute. Ils sont nombreux à
avoir besoin de temps pour l’admettre tant c’est monstrueux à leurs propres
yeux ce qu’ils ont fait. La faute n’est pas la culpabilité. Pour sortir de la
faute, il faut déjà sortir de la culpabilité.
« Nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et
nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en
Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l’amour atteint, chez nous, sa
perfection : avoir de l’assurance au jour du jugement ; comme Jésus,
en effet, nous ne manquons pas d’assurance en ce monde. Il n’y a pas de crainte
dans l’amour, l’amour parfait bannit la crainte ; car la crainte implique
un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n’a pas atteint la perfection
de l’amour. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le
premier. » (1 Jn 4, 16-18)
Aujourd’hui, le péché d’A. n’est pas son crime, commis il y
a un moment, mais son incapacité à se penser aimable, par Dieu même. Mais l’on
risque de mal s’entendre. Dire que c’est son péché, ce n’est pas dire que c’est
sa faute. Il est pris dans le mal. Il est incapable de se croire aimable.
Avant d’en venir au pardon, il faut faire ce chemin. Ou
plutôt, le pardon sera résurrection, il y aura pardon lorsqu’enfin, avec son
crime, il pourra s’aimer, ou au moins s’estimer. L’estime de soi naît de la
sollicitude d’autrui. Et beaucoup en ont été privés. Cela n’excuse pas le délit
ou crime, mais l’on ne restaurera pas l’humanité sans situer le crime ou le
délit dans l’ensemble d’une trajectoire de vie.
La critique portée contre la justice restaurative dit assez le
souci que je porte aux victimes. Cependant, on pourra trouver que le propos me
situe du côté des coupables. De leur côté, non, à leur côté, oui. A hauteur d’homme,
un je et un tu, évidemment différents mais égaux en dignité. Le crime et le
délit, la sanction plus encore, ne peuvent en rabattre sur la reconnaissance de
la dignité humaine et l’égalité en droit.
On pourra aussi penser que j’ignore des distinctions, entre
morale et droit par exemple, ou le fondement des systèmes judiciaire et carcéral.
Mais les grandes idées se fracassent contre la dure réalité des faits, de la
pratique pénale et carcérale. Les grandes idées ont les mains propres, mais
elles n’ont pas de main ! Lorsque la Justice organise le piétinement du droit
(par exemple en ce qui concerne les conditions de vie en détention), il n’est
pas possible d’imaginer qu’elle puisse éduquer les condamnés et encore moins
les prévenus, par définition présumés innocents, au respect du droit et de la
société.
Alors, le pardon en prison
Les raisons pour lesquels les détenus se rapprochent parfois
de la religion en détention sont multiples. (Thibault Ducloux, Illuminations carcérales, comment la vie en
prison produit du religieux, Labor et fides, 2023) Elles ne sont pas
toujours motivées par la foi. Et en soi, cela n’est pas un problème. Dans
l’enfer de l’incarcération, retrouver des copains, venir trouver la paix, avoir
une occasion de sortir de la cellule, avoir des relations autres que celles que
le cadre impose, trouver à se dire qui l’on est, partager, tout cela est très
bon.
Trouver du sens aussi. Pourquoi pas, si ça permet de vivre.
Pas sûr qu’il y ait du sens. Dieu n’est pas le sens, l’explication qui manque. Dietrich.
Bonhoeffer dénonce le Dieu bouche-trou du sens qui ne peut que reculer au fur
et à mesure que des réponses sont disponibles. Dieu est non-nécessaire écrit Eberhard
Jüngel, Dieu mystère du monde
(1977), La religion apporte des réponses là où l’on ne sait pas en trouver, mais
pas la foi. La religion, c’est de l’opium, comme disait Marx, même s’il dénonçait
un autre usage du religieux. C’est de l’illusion et, parfois, l’illusion permet
de traverser les abîmes. On aurait tort de s’en priver. L’évangile bien sûr
n’est pas insensé, mais il n’est pas là pour donner du sens. « Je crois
parce que c’est absurde » dit, au moins dans le fond, Tertullien, à la fin
du second siècle. Nous n’avons pas de raisons de croire, c’est pure gratuité.
Et dans le non-sens de l’existence que certains fréquentent plus que d’autres,
le Christ chemine et accompagne. Il ne résout pas l’absurde.
Si l’on fait l’histoire du sacrement du pardon ou l’histoire
des conceptions du péché, on verra que l’on n’a pas toujours entendu ce que
nous appelons ainsi. (On raconte que st Bernard +1153 ne recevait pas le
sacrement de la pénitence, mais qu’il pratiquait la coulpe monastique.) Souvent,
la célébration du sacrement de la réconciliation, c’est une manière de laver sa
conscience, d’ôter sa culpabilité. Ce n’est peut-être pas si mal que cela, mais
je ne crois pas que ce soit ce dont il s’agit. Et surtout pas le fait de se
refaire une conscience, de se racheter une conscience, le fait de n’être plus
pécheur, de n’avoir plus de péchés. Si c’est cela le pardon, c’est une
fumisterie, une hypocrisie, et tous ceux qui disent que chez nous chrétiens,
c’est facile, on fait le mal, on se confesse, et c’est reparti, ne caricaturent
pas tant que cela.
Je pense aux prêtres condamnés. Peuvent-ils à nouveau
exercer un ministère, au nom du pardon, de la miséricorde ? La question
est mal posée, et tant qu’on la posera ainsi, on ne trouvera pas de solution.
Et qui pardonne ? L’évêque qui donne une nouvelle nomination ? Mais
en quoi a-t-il été offensé ? Il ferait mieux de s’occuper des victimes.
Nous, disciples, nous croyons que la fraternité l’emporte
sur le mal. Mais encore faut-il renouer, tisser de nouveau la fraternité. Alors
on pourra accueillir. Avant de parler de pardon, on va essayer d’être les
témoins de ce que la fraternité est possible avec tous. Il me semble que je ne
donnerais l’absolution aux prêtres coupables qu’une fois la fraternité
restaurée.
Le pardon du coupable, y compris dans le sacrement, n’est
pas une affaire entre sa conscience et Dieu. Ce n’est pas non plus un acte
magique, religieux, mais la vive prise de conscience puis habitus que vivre,
c’est non ce que nous faisons, mais ce que nous recevons. « Qu’as-tu que
tu n’aies reçu ? » mais nous pensons que nous sommes ce que nous
avons fait ; d’autant plus si l’on a peu ou mal reçu. Vivre en grâce c’est
le contraire du péché, dont les fautes ne sont que l’expression.
Le pardon est un acte politique, social. D’une part, si nos
communautés chrétiennes savent vivre en fraternité avec des personnes qui ont
commis le mal (et qui n’est pas dans ce cas, même si tous n’ont pas commis de
délits ou de crimes, même si tous n’ont pas eu à rendre des comptes) elles
seront les prophètes de la réconciliation et du pardon. D’autre part, comme
style de vie, vivre de recevoir et de rendre grâce. Le pardon ne se décrète
pas, fût-ce par la célébration d’un sacrement, il est vie avec les pécheurs.
Illustration :
L’artiste dessine des cartes sur lesquelles des lettres sont inscrites. Au centre se présente un Joker. Les cartes font référence au jeu et au hasard.
Provenance : maison d’arrêt d’Angers
Artiste : inconnu
Date : 1995
Dimensions : 29.7 cm de longueur ; 21 cm de largeur
Matérialité : papier ; crayons noirs et de couleurs