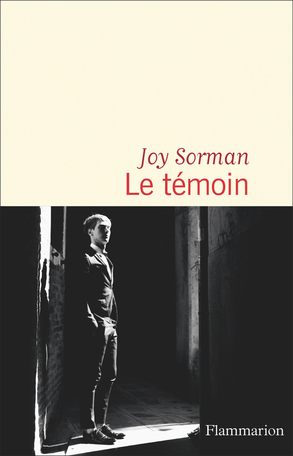|
| Alonso Berruguete (v. 1526-1532), Sacrifice d'Abraham (retable de San Benito el real, Valladolid) |
Il est encore temps de réfléchir à notre ascèse, nos efforts de carême. Une fois encore Luther a raison. Et tant pis pour ceux qui pensent que cela est contraire au catholicisme ! Luther qui n’a jamais été autre que catholique, fût-ce comme excommunié, est un maître spirituel qui nous engage plus décidément, plus véritablement, à la suite de Jésus. On relira Benoît XVI sur le moine augustin et réformateur, « chrétien passionné ». « La question de Dieu (...) fut la passion profonde et le ressort de sa vie et de son itinéraire tout entier". "La pensée de Luther, sa spiritualité toute entière était complètement centrée sur le Christ. »
Si nos efforts sont des œuvres, nos œuvres, nous sommes à côté de la plaque. C’est Pélage notre maître, et entre le risque de Pélage ou celui de Luther, le choix est d’autant plus vite fait que le catholicisme est en voie de sectarisation. L’élitisme de l’idéal de sainteté du premier confine à la séparation, ce que l’on dit en hébreu pharisaïsme et en latin secte.
C’est Dieu qui donne ! Du début à la fin. Cela s’appelle la
création, le salut, Dieu. Dieu donne… et notre boulot est de recevoir. « Comment pourrait-il, avec Jésus, ne pas nous donner tout ? » (Rm 8, 32)
Assez de ceux qui ont tout donné, de ceux qui se reprochent ‑ fausse humilité si orgueilleuse ‑ de ne pas assez donner, de ne pas assez se donner. C’est Dieu qui donne, nous avons tout « reçu, grâce après grâce » (Jn 1, 16). Plus on parle de grâce, moins on y croit : Il n’y a pas de grâces à demander. C’est fait, nous avons tout et tous reçu, grâce sur grâce !
On pourra citer les Actes : il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir (Ac 20, 35). Pour l’heure, laissons le bonheur à sa place, nous parlons de la suite du Christ, ce qu’est être disciple, se préparer à célébrer la résurrection avec un cœur et un esprit renouvelés, métanoïa, epistrophè, changement de manière de penser, retournement. La clef de la générosité, de la magnanimité est là ; le reste sera aussi donné, par-dessus le marché (Mt 6, 33).
Ce sont les gens religieux qui donnent. Ils s’imaginent qu’ils font plaisir à la divinité. Mais Dieu n’en a que faire. « Je ne t’accuse pas pour tes sacrifices ; tes holocaustes sont toujours devant moi. » (Ps 49/50) « Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils aux chefs de Sodome ! Prêtez l’oreille à l’enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe ! Que m’importe le nombre de vos sacrifices ? ‑ dit le Seigneur. Les holocaustes de béliers, la graisse des veaux, j’en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n’y prends pas plaisir. Quand vous venez vous présenter devant ma face, qui vous demande de fouler mes parvis ? Cessez d’apporter de vaines offrandes ; j’ai horreur de votre encens. Les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées, je n’en peux plus de ces crimes et de ces fêtes. Vos nouvelles lunes et vos solennités, moi, je les déteste : elles me sont un fardeau, je suis fatigué de le porter. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n’écoute pas : vos mains sont pleines de sang. » (Is 1, 10-15)
Si nous donnons quelque chose, c’est l’action de grâce, le remerciement. Encore faut-il recevoir pour rendre grâce. L’eucharistie n’est pas un rite, mais le remerciement d’une sainteté, d’une vie reçue, et donc juste et bonne, la sienne. Dieu se réjouit quand nous l’accueillons, lui, le donateur, le don et la capacité de le recevoir.
On aurait tout donné ; « mon
projet de mariage, ma carrière militaire, mon engagement sportif, mon 4x4, ma
moto, etc. » m’écrivait-on récemment. Mais enfin, carrière, sport, moto,
et richesses ne sont-ils pas ce que l’Eglise dénonce comme tentation
diabolique. On aurait tout sacrifié pour avoir renoncé à ce qui
ne vaut rien ? Se débarrasser des faux-dieux n’est pas tout donner. A l’opposé de la
veuve en son indigence, on conserve le meilleur qui fait vivre et assure ses arrières autant que sa réputation.
La ligature d’Abraham (Gn 22) raconte cela depuis les premières pages des Ecritures. Abraham veut tout donner. Donner moins que le fils ne serait pas tout donner. Et alors il tue, infanticide ! Il veut prouver ‑ à qui ? - son attachement à Dieu. Mais prouve-t-on l’amour ? Morale d’ingénieurs ou de juristes ! L’amour se reçoit, se croit ; il ne se prouve pas. La preuve tue la vérité, sauf dans les sciences, la technique, le droit ; c’est l’exception. La preuve tue l’amour.
Et Abraham tue le fils qu’il a reçu ; il s’apprête à tuer la grâce. Cela valait bien la peine de la demander, d’avoir
sans cesse ce mot de grâce à la bouche. Offrir un sacrifice avec son fils ne veut pas
dire offrir son fils en sacrifice, surtout avec l’offrande « que nous avons reçue de ta générosité » ! Ce n’est pas toi qui donnes, consens à recevoir. « Dieu
pourvoit » se tue à dire le texte par la bouche même du patriarche !
Il sait mais ne croit pas. Et nous ?