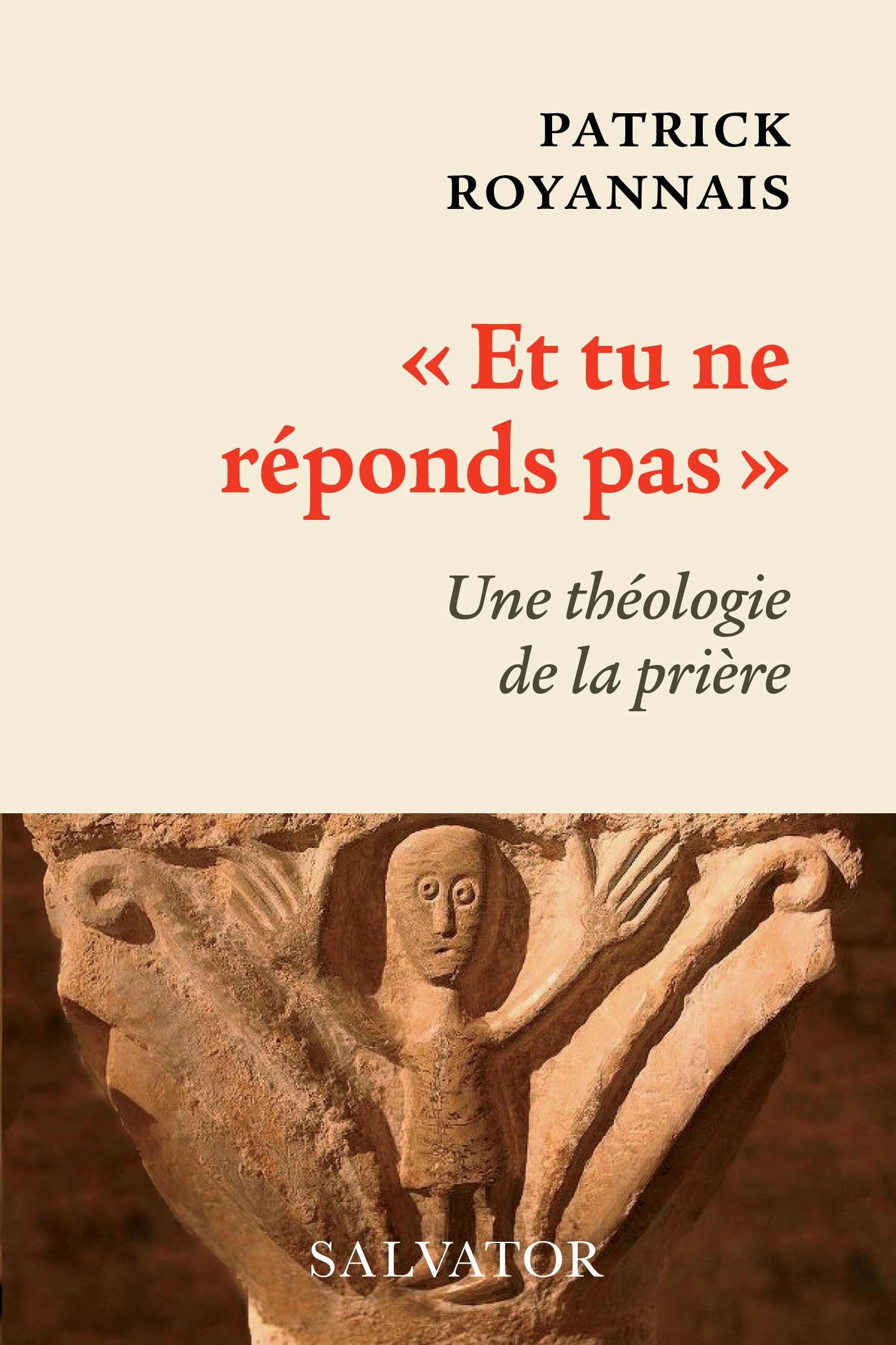La prière, comme un cri quand on n’en peut plus, quand il n’y a plus d’autre recours. C’est Hervé Guibert qui se surprend à prier, lui l’incroyant, emporté par le sida, et la destruction du corps. C’est Anthony, en détention préventive, qui n’en peut plus d’une instruction de plus de deux ans. Ce sont les victimes de viols au Tigré, plus d’une centaine de milliers de femmes, ignorées de toute justice. Ce sont les habitants de Gaza destinés à l’extermination, les malades hurlant leur peur dans la nuit des hôpitaux.
On pourrait multiplier les visages, les noms. Quelques instants de silence et nous devenons compagnons de tant d’hommes et de femmes, d’enfants, qui crient de crever, sans issue. Entendre leur cri, entendre le cri de leur prière nous ramène à notre impuissance. Si nous détournons le regard, ils sont morts ; à les en-visager, nous sommes désarmés.
Et nous croyons que Dieu est ainsi : Il pleure avec ceux qui pleure, humilié avec les humiliés, expulsé avec les immigrés dont on ne veut pas. Il meurt avec eux.
Quel peut bien être le sens de « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. » Ce n’est pas vrai ! On demande et ne reçoit pas…
L’évangile ment-il ? Faut-il l’interpréter contre la lettre ? Ou bien la lettre dit-elle autre chose que ce que nous entendons ? Je n’ai pas le temps de répondre à ces questions. Je ne veux pas en perdre à démonter les discours qui disent que si, Dieu, intervient. Je me contente de constater un monde dont Dieu est évincé. Sa toute-puissance ne se manifeste pas dans l’abracadabra d’un tour de magie surnaturelle qu’on appelle miracle, mais dans l’impuissante faiblesse qui voit mourir le fils sur la croix et tous les autres. Il faudrait parler du Dieu crucifié, de la Providence, de l’éviction de Dieu hors de ce monde comme chance et pour le monde et pour Dieu, et non comme drame, source de toutes les décadences. Mais mon introduction est déjà trop longue, qui commente le psaume : « Et tu ne réponds pas. »
Il faut essayer de dire quelque chose sur la prière, précisément dans ces conditions, précisément dans ces circonstances, à Gaza ou au Tigré, dans les Centres de rétention administrative ou les prisons, les hôpitaux ou les granges du suicide.
La prière ni n’informe Dieu, ni ne le fléchit, comme déjà l’écrivait Augustin. Elle ne sert à rien. Dans une société où le critère de validité est l’efficacité, ce qui rapporte, la prière est cri de l’inutile ; elle est le cri de la gratuité. Ceux dont nous avons fait mémoire, littéralement ou dans le recueillement personnel, au début de ce texte, le savent. Dans les vies méprisées, battues, abattues, pratiquer la gratuité d’un cri, c’est se dresser contre ce qui abat, un peu relevé, combattre l’inhumain qui étrangle pour demeurer dans la dignité d’exister.
Ils savent bien, celui que son expulsion me force à abandonner, celui dont la mort me sépare alors même que je lui tiens la main, celui que la prison brise et que je laisse à sa solitude désespérée ou à la promiscuité de la surpopulation, que l’écoute de son cri, parfois un silence assourdissant, ne le sort pas de sa situation. Mais, pour quelques heures à nouveau, il demeure un être humain, un vivant. « Tu as du prix à mes yeux » « Je veux que tu vives. »
Ce que nous faisons ou ce dont nous bénéficions par la bonté des frères et sœurs n’est que la pâle parabole de notre Dieu. C’est lui qui dit : « J’ai vu la misère de mon peuple. » « Tu as du prix à mes yeux. » « Je veux que tu vives. » « Aujourd’hui, tu seras avec moi. »
La prière est pro-testation, témoignage en faveur du Jour nouveau. Tournés vers l’Orient d’où surgit la lumière, debout comme les vivants, les mains levées, comme le crucifié dans le face-à-face avec celui que nous cherchons dès l’aube, nous attendons, nous veillons.
Les mots se révèlent vains, même les paroles de la prière de Jésus. C’est toute l’existence qui balbutie, non le nom de Dieu, mais une interpellation qui est aussi confiance et réconfort : « Toi, toi ».
La prière : « Toi » proféré dans le silence de l’absence, gratuité qui dit tout de ce toi.