 |
| Dominique Kaeppelin, Ecce homo (1997) |
La question que pose Jésus aux disciples insiste. « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Jésus ne pose pas une question de catéchisme à laquelle il attendrait la bonne réponse. On ne sait pas si la réponse de Pierre est la bonne. Elle est celle qui vaut « pour eux ». On ne demande pas à ses amis, ni à ses ennemis qui l’on est. Notre état civil, n’est pas une affaire de « pour vous ». La question de Jésus ne porte pas sur son état civil.
« Tu es le Christ. » Ce titre est très important pour le judéo-christianisme puisqu’il donne de nommer chrétiens les disciples de Jésus. Mais en quoi fait-il sens aujourd’hui, même si l’on en connaît les significations ? Faut-il entendre que Jésus est celui qui a reçu l’onction ? Cela n’est raconté nulle part ; ce serait donc en un sens second. Lequel ? Prophète eschatologique ou homme providentiel qui libèrera Israël ? Faut-il penser qu’il est descendant de David ? Mais en quoi cela est à ce point central dans la confession de foi ?
Pour les chrétiens du quatrième siècle qui rédigent les symboles de foi, ce titre n’a déjà plus beaucoup d’importance ; ils ne le retiennent pas. Avec le temps, il est devenu comme le nom propre de Jésus, sans plus, Jésus-Christ ; mais il ne fait plus sens.
Il n’en va pas de même avec l’expression fils du Dieu vivant. Dans la conversation avec des musulmans (pas forcément très au fait de leur foi ni de la nôtre), la question est souvent posée : Jésus est-il, oui ou non, le fils de Dieu ? Jésus a-t-il dit, oui ou non, qu’il l’est ? Mieux vaut refuser de répondre parce ces questions fermées enferment en dehors du « pour vous ». Elles cherchent une forme d’état civil ou de catéchisme. Or le mot Dieu, l’expression fils de Dieu, recouvrent tant de conceptions différentes voire opposées de Dieu, qu’il est aussi juste de répondre que Jésus est fils de Dieu qu’il ne l’est pas.
On ne peut la détacher la question de Jésus de son contexte narratif. Répondre à la question « pour vous, qui suis-je » (Mt 16, 13-20) c’est se déterminer pour ou contre Jésus, c’est dire comment nous nous situons par rapport à lui, c’est dire davantage sur qui nous sommes que sur qui il est.
Cela n’a rien d’extraordinaire. Quand d’une personne on dit qu’il est notre conjoint, notre ami, un salaud, une bonne personne, on dit comment l’on se situe par rapport à elle, on dit qui l’on est, conjoint, ami, ennemi. Les dictionnaires des noms propres sont pleins d’états civils, mais aucun ne répond à la question « pour vous », « pour vous, qui suis-je ». Et ce « pour vous » change tout parce qu’il nous implique dans l’aventure ou non avec Jésus. Et ce « pour vous » est indispensable : nous parlons de Jésus parce qu’il fait vivre aujourd’hui, qu’il détermine un style de vie ; il est celui pour ou contre qui l’on se positionne.
« Nous » ne répondrions évidemment pas la même chose que Pierre. Nous ne parlerions pas de christ. Peut-être de frère universel, de serviteur, de miséricordieux. Je fais exprès de retenir ces titres ; bibliques, ils continuent de faire trébucher, hésiter. Nous sommes mis en situation de répondre à la question de Jésus : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous » L’enjeu, c’est « pour toi ». Que fait son passage dans ta vie ? Y passe-t-il comme un vivant ou est-il quelqu’un d’un passé si éloigné qu’il n’est plus même ?
La réponse de Pierre provoque une conséquence, l’Eglise. La foi des Douze, la foi que Pierre représente est ecclésiale. C’est normal, c’est le « pour nous » des Douze qui est interpellé. L’assemblée ecclésiale est précisément ce qui est en jeu lorsque l’on répond ensemble, comme Douze. S’il y a une Eglise, une foi de l’Eglise, c’est pour que soit déliés du mal ceux qui ploient sous son poids, liés à Jésus, ceux qui ont besoin d’être attachés à lui.
La réponse ecclésiale ne vaut que pour autant que l’Eglise est la communauté chargée de libérer à la suite de Jésus. Une Eglise qui saurait des tas de choses sur Jésus mais serait lieu d’enfermement et de condamnation est un monstre, comme un agneau à tête de loup, qui se détruirait elle-même, se boufferait. C’est ce qui arrive lorsque quelques chapitres plus loin, à une question sur Jésus, Pierre répond : « je ne connais pas cet homme ». Tous sont partis, tous l’ont abandonné, Eglise désassemblée, morte, qu’il faudra délier de la mort comme avec les bandelettes de Lazare ou les linges dans le tombeau vide.
La question de Jésus est une question de vie ou de mort, pas de catéchisme ou de savoir. Ça te fait vivre ou non de dire qui est Jésus ? si oui, te voilà délié, libéré de ce qui sent la mort. Si non, méfie-toi, tu vas finir comme Pierre et son « je ne connais pas cet homme. » « Pour vous qui suis-je ? » signifie « Jésus, tu connais ? »


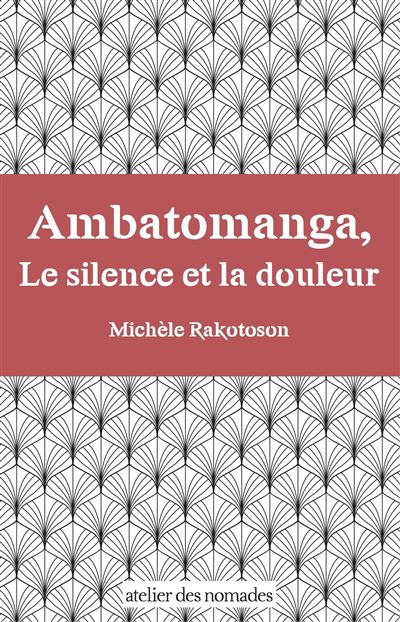 Atelier des nomades, 2022
Atelier des nomades, 2022